|
 |
Benjamin FOULON (FOULLON)
(Paris, après 1551 – Paris, 1612) |

enjamin Foulon fut le fils d’Abel Foulon et de la sœur de François Clouet, Catherine, mariés par contrat du 5 novembre 1550. Abel Foulon n’était pas artiste, mais inventeur. Originaire de Loué, dans le Maine, il servit pendant longtemps en qualité de secrétaire le sieur de Bois-Dauphin, évêque d’Agde, avant d’entrer au service du roi en tant que valet de chambre « suivant la Court ». Il fut inventeur entre autres de la fonte en cuivre des caractères, figures et pièces d’artillerie (il était parvenu à « réduire en cuivre, argent ou métal solide, les caractères, lettres et planches que les fondeurs, tailleurs et autres artisans ont accoustumé faire en plomb, estain et bois », ainsi que l’indiquent les termes du privilège royal du 17 juin 1551, lui accordant la faculté pendant dix années « de faire ou faire faire seul par telz artisans, ouvriers et imprimeurs que bon luy semblera, lesdits ouvrages, artifices et instumens »), de la construction de machines élévatoires et moulins sur des citernes ou eaux dormantes, de la locomotion de chariots par leurs propres poins, d’un instrument de mesure appelé « holomètre », de toutes sortes d’engins et machines et d’une démonstration du mouvement perpétuel. Sa science s’étendait aussi à la composition de divers livres : il avait préparé une traduction française de Vitruve, mais celle-ci fut dérobée par un ami, incident raconté par lui-même dans la préface d’Holomètre (Usaige et description de l’Holomètre pour sçavoir mesurer toutes choses qui sont soubs l’estanduë de l’œil, tant en longueur et largeur qu’en hauteur et profondité, inventé par Abel Foullon, vallet de chambre du Roy, Pars, P. Béguin, 1555). Il s’agit sans doute de la traduction de Vitruve éditée en 1547 sous le nom de Jean Martin. La Croix du Maine lui attribue encore l’invention des testons, forgés sous Henri II à la Monnaie du Moulin, établie en 1551 au titre d’annexe de la Monnaie de Paris. Employé à Orléans à préparer la monnaie au coin du roi, Abel Foulon y mourut en 1563.
On ne sait pas s’il existait un lien de parenté entre Abel Foulon et Pierre Foullon, peintre originaire d’Anvers, qui participa, en 1538, à la construction, dans la chapelle du château d’Oiron, de la tombe d’Artus Gouffier et d’Hélène de Hangest, que leur fils, Claude Gouffier, voulait ériger. Claude Gouffier le fit naturaliser Français, par lettres du 18 décembre 1538, « sans payer aucune finance, à la charge de se marier en France. »
Abel Foulon et Catherine Clouet eurent trois enfants : Marie, baptisée en église Saint-Nicolas-des-Champes le 1er juin 1562 (son parrain fut le sire Jean Aubery l’aîné, et ses marraines « Antoinette Jacquelin, femme de maître Nicolas du Hamel, avocat en la cour [du Parlement de Paris], demeurant rue Sainte Avoye », et « Geneviève du Pré, femme de maître Pierre Fermé ») ; Catherine, mariée au noble homme maître Guillaume de Villiers, avocat en Parlement ; et Benjamin, peut-être l’aîné.
Benjamin Foulon fut probablement formé dans l’atelier de son oncle, François Clouet. Son nom est mentionné pour la première fois en 1576-1578, parmi les « pensionnaires du roy en son Espargne », en compagnie de sept autres peintres, dont Éloy Le Mannier, Etienne Dumonstier et les Decourt, et un émailleur, Bernard Limosin. Il touchait alors 400 l. t., autant qu’Étienne Dumonstier. Foulon passa ensuite au service de la reine mère, sans quitter celui du roi : il apparaît dans les comptes de la maison de Catherine de Médicis établis en 1583 parmi les « peintres » avec le traitement de 400 l. t., mais en même temps dans l’Etat des officiers domestiques du Roy pour la même année :
| |
« A Benjamin Foullon, nepveu de feu Me [laissé en blanc] Jamet, aussi painctre dedictes (sic) majestés [Henri III et Catherine de Médicis], la somme de six vingt treize escus, vingt sols tournois, à luy ordonnée par ledict estat, cy-devant rendu, pour ses gaiges par luy desserviz durant l’année de ce présent compte, de laquelle somme payement lui a esté faict comptant par ledict présent trésorier et receveur général, comme d’icelluy appert par quatre quictances passées par devant notaires ou Chastellet de Paris, en datte des dix-neufvième jour d’avril, neufviesme jour de juillet, douzieme jour d’octobre mil cinq cens quatre vingtz trois et septiesme jour de janvier mil cinq [quatre vingt quatre, la feuille est rognée]. » |
Cent trente-trois écus étant l’équivalent exact de 400 livres tournois, tout porte à croire que Foulon reçut la somme qu’une seule fois. Le même salaire lui fut attribué en 1587 :
| |
« Peintres
Pierre Gourdel
Pierre Du Monstier C écus dont toutesfois il ne sera icy paié, d’aultant qu’il en est assigné ailleurs
Cosme du Monstier [laissé en blanc] dont toutefois il ne sera icy paié, d’aultant qu’il en est assigné ailleurs
Benjamin foulon nepveu de feu Me Jainet
Roger de Rogery
[laissé en blanc], painctre de feu (sic) Mlle Gondy |
VIxx xiij écus
VIxx xiij écus
LVIxx xiij écus
L écus. » |
Foulon travailla pour la reine mère jusqu’à la mort de cette dernière, survenue en 1589. Son nom figure parmi les créanciers de Catherine dans l’Arrêt du Parlement de Paris prononcé le 23 août 1601, car ce n’est que cette année qu’il toucha les cent trente-trois écus un tiers pour ses gages de 1588. Il était alors depuis au moins dix ans au service de Henri IV en tant que peintre et valet de chambre. En cette qualité il reçut, le 6 janvier 1592, 300 écus pour un voyage fait à Tours dans l’armée du roi et pour plusieurs tableaux exécutés par lui pendant son séjour à l’armée. Le 11 août 1597, il signa une quittance relative à la constitution par lui et son épouse, Nicolle Watier, de 133 écus un tiers de rente annuelle sur l’Hôtel de ville (dont le titre lui venait de sa mère, Catherine Clouet) au profit de Guillaume de Villiers, avocat en Parlement et Catherine Foulon, sa femme, la sœur de Benjamin. Dans l’état de 1599 son nom apparaît parmi les « peintres qui auront aussy qualité de vallets de chambre » avec 33 écus d’appointements (il y est placé après Étienne Dumonstier, mais avant Jehan Doué et Marin le Bourgeois), puis dans celui de 1609, avec « les gaiges de cent livres de laquelle somme le trésorier n’en a paié aucune chose faulte de fonds ». Cependant, ce même trésorier payait « Jehan et Claude Dhoey, autres paintres ».
La seconde épouse de Foulon fut Marie Michel, qu’il épousa en 1605 ou 1606, et dont il eut une fille, Françoise. Il avait eu précédemment un fils Pierre, baptisé à Saint-Eustache le 25 novembre 1604. La mère de l’enfant est désignée dans le registre paroissial sous le nom de Françoise Nicole, mais il s’agit probablement de Nicolle Watier.
Foulon semble être surtout un dessinateur de crayons, au style propre, un peu maladroit et parfois médiocre. Sa clientèle est surtout celle de la cour, et sa signature – « foulonius fecit » – figure sur le portrait de César de Vendôme. Mais il portraiturait également des nobles de lignées modestes, voire des bourgeois. Les études manquent singulièrement sur cet artiste important. |
|
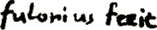 |
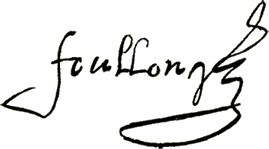 |
|
|



